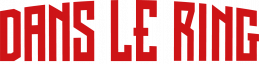« Un combat de boxe, c’est comme un film de cow-boy. Il doit y avoir un gentil et un méchant. Et les gens viennent voir le méchant perdre ». De ce trait d’esprit aussi fulgurant que son punch, Sonny Liston a parfaitement résumé le lien unissant le monde de la boxe à celui du cinéma. Ce délinquant multirécidiviste – sauvé par le gong – jouait d’ailleurs à merveille son rôle de bad boy, tant sur le ring que sur la pellicule de films tel que « Moonfire » de Michael Parkhurst. De Georges Carpentier à Stéphane Ferrara, nombreux sont les boxeurs qui, comme lui, ont quitté la sueur de leur salle d’entraînement pour le fard des plateaux de cinéma.
Les réalisateurs apprécient sûrement leur capacité à occuper l’espace, leur facilité à s’exprimer à travers leur corps et surtout leur “gueule” cinégénique. Si le noble art est un des sports les plus représentés au cinéma, c’est sans doute parce qu’il se joue quelque chose entre les cordes du carré magique que l’on retrouve également sur le grand écran, qui tient de la tragédie humaine : la lutte entre deux entités pourtant si proches l’une de l’autre mais qui se terminera inexorablement par la victoire de l’une, et la défaite potentiellement mortelle de l’autre. Pour toutes ces raisons, nous avons souhaité consacrer un dossier au mariage heureux de la boxe au cinéma, déjà plus que centenaire.
 Dans la vie comme sur un ring, il faut encaisser les coups pour pouvoir avancer, savoir se relever après avoir été mis au tapis. Cette métaphore explique peut-être que la boxe soit le sport le plus représenté à l’écran. Le film de boxe peut parfois nous faire rire, d’autres fois pleurer. Il peut raconter l’ascension sociale d’un self-made man aussi bien que sa descente aux enfers, dénoncer les inégalités sociales et raciales. Il peut montrer du doigt la violence du pugilat mais aussi exalter la beauté du noble art, révéler le côté obscur du boxing business tout en magnifiant le courage et la dignité des boxeurs. Depuis l’avènement du cinématographe, les plus grands réalisateurs se sont confrontés à l’univers de la boxe anglaise. Traversant les genres et les années, le film de boxe a plusieurs fois changé de forme en fonction du contexte.
Dans la vie comme sur un ring, il faut encaisser les coups pour pouvoir avancer, savoir se relever après avoir été mis au tapis. Cette métaphore explique peut-être que la boxe soit le sport le plus représenté à l’écran. Le film de boxe peut parfois nous faire rire, d’autres fois pleurer. Il peut raconter l’ascension sociale d’un self-made man aussi bien que sa descente aux enfers, dénoncer les inégalités sociales et raciales. Il peut montrer du doigt la violence du pugilat mais aussi exalter la beauté du noble art, révéler le côté obscur du boxing business tout en magnifiant le courage et la dignité des boxeurs. Depuis l’avènement du cinématographe, les plus grands réalisateurs se sont confrontés à l’univers de la boxe anglaise. Traversant les genres et les années, le film de boxe a plusieurs fois changé de forme en fonction du contexte.
Du rire aux larmes
Dès les débuts du cinéma, la boxe est au premier plan. Elle forme bien vite un mariage heureux avec le burlesque, aussi bien en France en la personne de Max Linder que dans le monde anglo-saxon avec Charlie Chaplin, Buster Keaton et Harold Lloyd. Ces artistes se servent de la boxe comme ressort comique en faisant monter sur le ring des petits gringalets qui n’ont jamais mis les gants de leur vie. Aussi bien les pantalonnades d’un Charlie Chaplin que les films de boxe dramatiques dénoncent les inégalités sociales.
Multipliant les cascades pour s’en sortir, les deux boxeurs mis en scène dans « Les Lumières de la ville », se battent pour remplir leur assiette. Dans un autre registre, « The Champ » de King Vidor raconte l’histoire d’un boxeur fini qui remonte sur le ring par amour pour son fils, avant de perdre la vie sous les coups de son adversaire. Même scénario pour « Winner Take All », réalisé en 1932 par Roy Del Ruth, dans lequel le personnage principal remet les gants pour subvenir aux besoins de sa famille. A la fin du film, les deux adversaires se mettent simultanément knock-down mais le héros parvient à se relever avant la fin du décompte de l’arbitre. Cette scène sera reprise des années plus tard dans Rocky II par Sylvester Stallone.
Dans « Homeboy », réalisé en 1988, Michael Seresin raconte quant à lui l’histoire d’un boxeur minable et alcoolique devant choisir entre sa rédemption et une chance pour le titre. Mickey Rourke est à la fois le scénariste et l’interprète du personnage principal de ce film sombre et violent, lui qui a longtemps hésité entre les carrières d’acteur et de boxeur. Entre 1991 et 1994, il a même mis sa carrière de comédien entre parenthèses pour livrer huit combats professionnels qu’il remportera mais qui le laisseront ruiné et défiguré à la manière du personnage qu’il avait créé.

Lumières sur le boxing business
Dans l’entretien qu’il nous a accordé, Dominique Ladoge – réalisateur du « Montreur de boxe » en 1996 – évoque avec une certaine nostalgie « ces films américains en noir et blanc qui appartiennent aux années 40-50, comme le magnifique « Nous avons gagné ce soir de Robert Wise ». Les films noirs ont marqué l’imaginaire du noble art, et le moins que l’on puisse dire est qu’il n’y est pas en odeur de sainteté. Influencés par le cinéma expressionniste allemand, les réalisateurs rattachés à ce courant usent d’une mise en scène hautement symbolique et d’un éclairage très contrasté. Porteurs d’une vision pessimiste de la société, ils mettent la lumière sur les aspects les plus sombres du milieu pugilistique. Dans des décors urbains souvent filmés de nuit et par temps de pluie se côtoient boxeurs finis, managers véreux, mafieux et femmes fatales.
Typique du genre, le film « Sang et Or » de Robert Rossen révèle en clair-obscur la mainmise de la pègre sur le marché de la boxe, décidant qui gagne et qui se couche en fonction des paris. Même combat dans « Nous avons gagné ce soir », où Robert Wise met en scène un vieux boxeur courageux dont le manager – qui ne croit plus en lui depuis longtemps – a convenu d’avance la défaite avec la mafia sans même lui en parler, gardant ainsi les bénéfices de ce pacte à son unique profit. A cette époque plane sur le monde de la boxe l’ombre de Frankie Carbo, ponte de la mafia new-yorkaise, qui n’hésitait pas à arranger les matchs en fonction de ses intérêts.
En 1956, Mark Robson va encore plus loin dans « Plus dure sera la chute » en décrivant une carrière de boxeur montée de toute pièce par des managers véreux et des journalistes en manque de scoops. Le scénario est directement inspiré de la carrière polémique du champion du monde Primo Carnera, dont la plupart des matchs étaient truqués si l’on en croit Léon Sée, son premier manager. Le film jettera d’ailleurs l’opprobre sur cette ancienne star des rings, reconvertie au catch.
Les stars du ring à l’écran
Inspirés par les parcours exceptionnels des boxeurs, de nombreux réalisateurs s’emparent de leurs histoires. Ainsi, « Gentleman Jim » de Raoul Walsh est consacré à l’itinéraire du premier champion du monde respectant les règles du marquis de Queensberry, James J. Corbett. Cette success story fait l’éloge d’un self-made man qui se hisse à la force de ses poings au sommet de la pyramide sociale, accomplissant ainsi le rêve américain. Dans « Marqué par la haine », Robert Wise évoque lui aussi la réussite mais cette fois comme une rédemption, à travers la vie de Rocky Graziano. Ce mauvais garçon découvre la boxe en prison et, grâce à elle, devient un symbole de fierté pour son quartier.

Mais celui qui va porter le biopic de boxe à son apogée, c’est évidemment Martin Scorsese avec « Raging Bull » en 1980. Contrairement à la majorité des cinéphiles, le réalisateur Dominique Ladoge considère que “tout le génie de Scorsese réside dans la psychologie des personnages et leur environnement. En ce qui concerne les combats en eux mêmes, il y a des choses formidables comme les pipettes à faire gicler du sang, mais on voit aussi les coups de poing passer à 50 cm du nez. « Tout Scorsese qu’il est, maître incontesté et incontestable, il y aurait à redire sur les combats.” Tout en noir et blanc, comme pour exprimer la binarité de ce personnage paranoïaque, le réalisateur projette sur l’écran l’autodestruction de Jake LaMotta dans le ring comme en dehors. On se souvient encore des gouttes de sang perlant en gros plan le long des cordes du ring, ou encore des éclaboussures d’hémoglobine sur le public. Fidèle au thème de la résilience, ce n’est qu’après avoir souffert le martyr face à Sugar Ray Robinson que le boxeur trouve enfin la paix intérieure.
Dans « Ali » en revanche, Michael Mann retrace le parcours de Mohamed Ali moins pour glorifier sa carrière que pour honorer son combat contre les inégalités raciales. La boxe y apparaît ainsi comme un moyen de lutte contre l’oppression et non pas comme un ascenseur social. Comme en témoignent les derniers long-métrages consacrés au noble art, tel « Hands of Stone » sorti en 2016 sur Roberto Durán, le biopic de boxe a toujours le vent en poupe.
Du nouvel Hollywood au film d’action
La boxe est encore présente dans le Nouvel Hollywood qui naît dans les années 1970, pour mettre la lumière sur les laissés pour compte du rêve américain. « Fat City », réalisé par John Huston en 1972, en est sûrement l’exemple le plus frappant. Le cinéaste représente les boxeurs comme un prolétariat corvéable à merci, et la boxe comme un miroir aux alouettes sur lequel ils viennent se casser les dents.
Avec la saga mythique de Sylvester Stallone, le film de boxe bascule enfin dans le film d’action. Rocky Balboa est toujours le loser du Nouvel Hollywood, certes, mais il va avoir la chance de vivre le rêve américain en affrontant le champion du monde des lourds. Le film d’action ouvre ainsi la porte aux boxeurs bodybuildés, montages serrés, entraînements clipesques filmés à la steadycam (système stabilisateur de prise de vues portatif inventé par l’Américain Garrett Brown, utilisé pour la première fois au cinéma dans Rocky (Avildsen, 1976) durant ses footings.), bruitages explosifs, combats spectaculaires et autres bandes-sons à couper le souffle. Dans ces films, c’est bien souvent la loi du Talion qui domine, à l’image de la vengeance de la mort d’Apollo dans Rocky IV. Mais cette saga est bien plus que cela. Elle a poussé les foules vers les salles de boxe, motivé des générations à dépasser leurs limites et même suscité des vocations. « Moi, la sortie du premier Rocky m’a donné envie de faire de la boxe (…) Bien sûr, je connaissais Mohamed Ali et d’autres grands boxeurs, mais Stallone m’a fait encore plus aimer ce sport » confiera Fabrice Bénichou à LCI en 2016.
Depuis les débuts du cinéma, la boxe est sous le feu des projecteurs. A travers les genres et les années, les plus grands cinéastes se sont attaqués au noble art en y apportant à chaque fois un regard nouveau. Sans doute y a-t-il entre les douze cordes d’un ring, quelque chose de la tragédie humaine que tant d’artistes s’évertuent à exprimer. Si vous souhaitez aller plus loin, « La boxe à Hollywood » de David Da Silva, sorti en 2017, fait référence sur le sujet.